Installer l'application
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
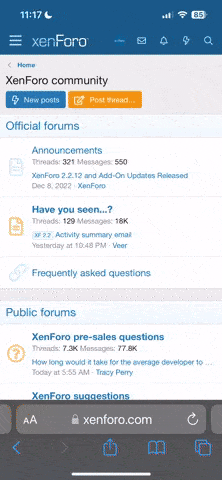
Note: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
-
Rentre dans la mêlée des discussions enflammées ! :) Inscris toi en 2 minutes, et même en 10 secondes grâce à ton compte Facebook ! Les supporters t'attendent pour partager des avis ! JE M'INSCRIS ›››
Vous utilisez un navigateur obsolète. Il se peut qu'il n'affiche pas correctement ce site ou d'autres.
Vous devez le mettre à niveau ou utiliser un navigateur alternatif.
Vous devez le mettre à niveau ou utiliser un navigateur alternatif.
MARCEL DAGRENAT DANS LE MIDOL DU 24/04/2020
- Auteur du sujet jfm66
- Date de début
jo basile
Passe sa vie sur le forum
Crois-tu qu'il ait une solution ? Veut-il racheter l'Usap ou se placer en attendant que "ça se casse la gueule"?Bizarre cet article maintenant...
Eusebio Cafarelli
Passe sa vie sur le forum
Faut meubler...Bizarre cet article maintenant...
Verdouble
USAPiste bavard
On peut dire ce qu'on veut, la réalité c'est que sous l'ère Dagrenat:
- l'Usap est passé d'un club moyennas à un prétendant quasi immuable aux phases finales et un sérieux concurrent en H-Cup
- Les finances étaient gérées de main de maitre
- on avait une équipe était ultra compétitive quand il a été foutu dehors comme un malpropre
En 5 ans de temps, on est passé de ça à la Pro D2 avec 3MM de trou dans les caisses, et un paquet de conneries cumulées par ses successeurs:
- Faire resigner à prix d'or et pour 3 ans nos vieux suite au titre de 2009 (le pêché originel)
- Décider de jouer un match critique pour notre survie dans l'élite à Barcelone plutôt qu'à AG: on a vu le résultat...
- Ouvrir des boutiques, des brasseries, (et pourquoi pas un parc d'attractions tant qu'on y est ...) siglées USAP, avec les conséquences financières qu'on connait: pas sur que "l'épicier" aurait eu une telle folie des grandeurs
- Garder Delpoux qui nous à trainé au fond du trou...
- Croire qu'on pouvait se maintenir en Top 14 avec une équipe quasi inchangée de Pro D2
J'en passe et des meilleures....
Ce que je regrette le plus, c'est le pragmatisme et le discours de vérité: je préfère ça plutôt que l'enfumage permanent auquel on a droit depuis que Rivière est en place.
Je suis plus enclin à écouter un vendeur de fruits et légumes qu'un vendeur de rêve.
- l'Usap est passé d'un club moyennas à un prétendant quasi immuable aux phases finales et un sérieux concurrent en H-Cup
- Les finances étaient gérées de main de maitre
- on avait une équipe était ultra compétitive quand il a été foutu dehors comme un malpropre
En 5 ans de temps, on est passé de ça à la Pro D2 avec 3MM de trou dans les caisses, et un paquet de conneries cumulées par ses successeurs:
- Faire resigner à prix d'or et pour 3 ans nos vieux suite au titre de 2009 (le pêché originel)
- Décider de jouer un match critique pour notre survie dans l'élite à Barcelone plutôt qu'à AG: on a vu le résultat...
- Ouvrir des boutiques, des brasseries, (et pourquoi pas un parc d'attractions tant qu'on y est ...) siglées USAP, avec les conséquences financières qu'on connait: pas sur que "l'épicier" aurait eu une telle folie des grandeurs
- Garder Delpoux qui nous à trainé au fond du trou...
- Croire qu'on pouvait se maintenir en Top 14 avec une équipe quasi inchangée de Pro D2
J'en passe et des meilleures....
Ce que je regrette le plus, c'est le pragmatisme et le discours de vérité: je préfère ça plutôt que l'enfumage permanent auquel on a droit depuis que Rivière est en place.
Je suis plus enclin à écouter un vendeur de fruits et légumes qu'un vendeur de rêve.
Ou bien... ou bien c'est un test ou un message.Faut meubler...
C'est quand même pas sympa pour l'USAP 2020 et son président, ça tombe comme un cheveu dans la soupe.
... Outre que l'article élude totalement la vrai raison du départ de Dagrenat qui voulait vendre l'USAP et empocher sa plus value.
Cargol66
Passe du temps sur le forum
L'INTERVIEW #Midol
Marcel Dagrenat - Ancien président de Perpignan
« Je ne suis jamais retourné au stade »
Il fut président de l’USAP pendant huit ans, figure du rugby professionnel des années 2000 avec un vrai franc-parler et un gros tempérament. Marcel Dagrenat a quitté ses fonctions en 2007, sans titre majeur, mais en laissant une trace. Il fut mis en minorité par ses co-actionnaires (Vails, Athanec, Sobraquès, Velarte… et Paul Goze lui succéda). Il n’a guère fait parler de lui depuis.
Propos recueillis par Jérôme Prévôt
jerome.prevot@midi-olympique.fr
Dans les années 2000, on parlait beaucoup de vous dans l’actualité. On vous a un peu perdu de vue depuis votre départ. Que devenez-vous ?
Je suis retraité, mais je m’occupe quand même de mes affaires, de l’immobilier essentiellement. Je m’occupe aussi de ma famille, et je voyage. Je vis toujours dans la banlieue de Perpignan.
Avec le recul, quel souvenir gardez-vous de votre présidence de l’Usap ?
Un très bon souvenir. Je venais de la grande distribution, un univers dur où on vivait un peu en vase clos. L’Usap m’a permis de rencontrer plein de personnes intéressantes. Sans vouloir être pompeux, j’ai découvert l’« être humain ». Il y avait aussi le fait que j’ai pris la présidence au moment du passage au professionnalisme, nous sommes partis d’une feuille blanche... Quand je prends l’Usap, je le fais en décembre en catastrophe alors que nous sommes proches de la relégation. C’était un sacré pari surtout financier. Pendant les deux premiers mois, j’ai assuré la paye avec mon argent personnel. Sinon, on était en faillite. Des dirigeants qui étaient là depuis vingt ans me disaient que je n’y arriverais pas, que je ne payerais jamais les charges sociales. On venait d’un monde où on rétribuait les joueurs sur dix mois avec des enveloppes. Et où on s’arrangeait à la bonne franquette avec le président de la FFR. J’ai dit que ça ne se passerait plus comme ça. J’ai essayé de faire du club une vraie entreprise. Certains m’ont fait les gros yeux, c’est vrai.
Quand vous parlez de l’humain, à quoi faites-vous allusion ?
J’ai appris à gérer des salariés, les joueurs, d’une autre espèce que ceux que j’avais connus avant. J’ai appris à voir qui était mes vrais amis, qui étaient des faux culs. J’ai découvert la trahison. Mais je me suis surtout régalé à travailler pour tous ces supporters, le peuple catalan que nous avons quand même amenés au Stade de France.
Qu’avez-vous amené de nouveau pour faire franchir un pas à l’Usap ?
Le club c’était une subvention municipale, une poignée de partenaires qui mettait des panneaux autour du stade, un repas avec quarante personnes. Pour progresser, je me suis inspiré des méthodes du Stade toulousain. J’ai attiré de nouveaux partenaires, en définissant trois catégories, le local qui voulait aider sans rien avoir en retour, puis les régionaux qui attendaient un retour et enfin quelques nationaux. Tout ça a créé une dynamique.
Et sur le plan du capital que s’est-il passé ?
On a commencé en association, puis on a fait une SAOS, puis une SASP avec ouverture du capital. Je voulais avoir la majorité, mais on m’a répondu, Paul Goze en tête : « Comment ? Le club doit appartenir au peuple catalan ! » Ça me fait sourire quand je vois ce que c’est devenu depuis. J’ai répondu : « Pourquoi pas ? Je ne suis que de passage après tout. » Alors on s’est réparti le capital. C’est ce qui leur a permis de se mettre d’accord et de me mettre dehors par la suite.
Pourquoi ont-ils fait ça ?
Ça marchait, on avançait, le stade était plein, la Catalogne Sud nous soutenait. Ils ont cru que c’était facile. Et comme ils voulaient un retour personnel pour leur ego ou que sais-je encore… Quelques années après, ils étaient en D2, mais avec un titre au passage en 2009, il faut le reconnaître.
Ce Brennus de 2009, vous ne pouvez pas leur enlever ça…
Oui, je leur avais laissé un budget, un effectif et un entraîneur. Ils ont rajouté Dan Carter, c’est vrai. (N.D.L.R. : Le joueur blessé en janvier n’aura que très peu joué)
Regrettez-vous de ne pas avoir eu la majorité des parts de la SAOS ?
Oui, évidemment d’autant plus que quand j’ai pris la tête du club, personne ne voulait de cette fonction. Mais je pensais que ces gens étaient comme les joueurs, motivés par l’amour du blason. Quelque temps après, mon départ, ils l’ont vendu au premier mécène qui s’est proposé. Où sont-ils tous ces hommes ? Goze je sais où il est, mais les autres ? Ils ont cavalé.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
La finale au Stade de France, même si elle a été perdue face au Stade français, puis la demi-finale européenne de 2003 gagnée sur le terrain du Leinster contre toute attente. Un vrai grand moment.
Étiez-vous un président mécène ?
Non justement, je n’étais pas un mécène. Avant de devenir président, j’étais partenaire. J’avais même payé directement pour faire venir un joueur, un arrière sud-africain qui n’a pas amené grand-chose d’ailleurs. Mais devenu président, je n’ai plus voulu mélanger mon argent avec celui du club. Ma doctrine, c’était mettre sur pied une véritable économie. Un club comme une entreprise. En huit ans, je n’ai jamais fini une saison en déficit, comptes contrôlés par la ville de Perpignan. Parfois des joueurs sont venus dans mon bureau avec des propositions venues de Biarritz par exemple. Ils succombaient à l’argent de Serge Kampf. Je leur disais : « Vas-y ! » Ils repartaient mécontents, c’est sûr. Ils auraient voulu rester à Perpignan avec le soleil, la mer, la montagne et les salaires de Paris, Clermont et Biarritz. Mais je ne pouvais les augmenter. Je n’ai jamais démarré une saison avec un budget prévisionnel en déficit.
Marcel Dagrenat - Ancien président de Perpignan
« Je ne suis jamais retourné au stade »
Il fut président de l’USAP pendant huit ans, figure du rugby professionnel des années 2000 avec un vrai franc-parler et un gros tempérament. Marcel Dagrenat a quitté ses fonctions en 2007, sans titre majeur, mais en laissant une trace. Il fut mis en minorité par ses co-actionnaires (Vails, Athanec, Sobraquès, Velarte… et Paul Goze lui succéda). Il n’a guère fait parler de lui depuis.
Propos recueillis par Jérôme Prévôt
jerome.prevot@midi-olympique.fr
Dans les années 2000, on parlait beaucoup de vous dans l’actualité. On vous a un peu perdu de vue depuis votre départ. Que devenez-vous ?
Je suis retraité, mais je m’occupe quand même de mes affaires, de l’immobilier essentiellement. Je m’occupe aussi de ma famille, et je voyage. Je vis toujours dans la banlieue de Perpignan.
Avec le recul, quel souvenir gardez-vous de votre présidence de l’Usap ?
Un très bon souvenir. Je venais de la grande distribution, un univers dur où on vivait un peu en vase clos. L’Usap m’a permis de rencontrer plein de personnes intéressantes. Sans vouloir être pompeux, j’ai découvert l’« être humain ». Il y avait aussi le fait que j’ai pris la présidence au moment du passage au professionnalisme, nous sommes partis d’une feuille blanche... Quand je prends l’Usap, je le fais en décembre en catastrophe alors que nous sommes proches de la relégation. C’était un sacré pari surtout financier. Pendant les deux premiers mois, j’ai assuré la paye avec mon argent personnel. Sinon, on était en faillite. Des dirigeants qui étaient là depuis vingt ans me disaient que je n’y arriverais pas, que je ne payerais jamais les charges sociales. On venait d’un monde où on rétribuait les joueurs sur dix mois avec des enveloppes. Et où on s’arrangeait à la bonne franquette avec le président de la FFR. J’ai dit que ça ne se passerait plus comme ça. J’ai essayé de faire du club une vraie entreprise. Certains m’ont fait les gros yeux, c’est vrai.
Quand vous parlez de l’humain, à quoi faites-vous allusion ?
J’ai appris à gérer des salariés, les joueurs, d’une autre espèce que ceux que j’avais connus avant. J’ai appris à voir qui était mes vrais amis, qui étaient des faux culs. J’ai découvert la trahison. Mais je me suis surtout régalé à travailler pour tous ces supporters, le peuple catalan que nous avons quand même amenés au Stade de France.
Qu’avez-vous amené de nouveau pour faire franchir un pas à l’Usap ?
Le club c’était une subvention municipale, une poignée de partenaires qui mettait des panneaux autour du stade, un repas avec quarante personnes. Pour progresser, je me suis inspiré des méthodes du Stade toulousain. J’ai attiré de nouveaux partenaires, en définissant trois catégories, le local qui voulait aider sans rien avoir en retour, puis les régionaux qui attendaient un retour et enfin quelques nationaux. Tout ça a créé une dynamique.
Et sur le plan du capital que s’est-il passé ?
On a commencé en association, puis on a fait une SAOS, puis une SASP avec ouverture du capital. Je voulais avoir la majorité, mais on m’a répondu, Paul Goze en tête : « Comment ? Le club doit appartenir au peuple catalan ! » Ça me fait sourire quand je vois ce que c’est devenu depuis. J’ai répondu : « Pourquoi pas ? Je ne suis que de passage après tout. » Alors on s’est réparti le capital. C’est ce qui leur a permis de se mettre d’accord et de me mettre dehors par la suite.
Pourquoi ont-ils fait ça ?
Ça marchait, on avançait, le stade était plein, la Catalogne Sud nous soutenait. Ils ont cru que c’était facile. Et comme ils voulaient un retour personnel pour leur ego ou que sais-je encore… Quelques années après, ils étaient en D2, mais avec un titre au passage en 2009, il faut le reconnaître.
Ce Brennus de 2009, vous ne pouvez pas leur enlever ça…
Oui, je leur avais laissé un budget, un effectif et un entraîneur. Ils ont rajouté Dan Carter, c’est vrai. (N.D.L.R. : Le joueur blessé en janvier n’aura que très peu joué)
Regrettez-vous de ne pas avoir eu la majorité des parts de la SAOS ?
Oui, évidemment d’autant plus que quand j’ai pris la tête du club, personne ne voulait de cette fonction. Mais je pensais que ces gens étaient comme les joueurs, motivés par l’amour du blason. Quelque temps après, mon départ, ils l’ont vendu au premier mécène qui s’est proposé. Où sont-ils tous ces hommes ? Goze je sais où il est, mais les autres ? Ils ont cavalé.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
La finale au Stade de France, même si elle a été perdue face au Stade français, puis la demi-finale européenne de 2003 gagnée sur le terrain du Leinster contre toute attente. Un vrai grand moment.
Étiez-vous un président mécène ?
Non justement, je n’étais pas un mécène. Avant de devenir président, j’étais partenaire. J’avais même payé directement pour faire venir un joueur, un arrière sud-africain qui n’a pas amené grand-chose d’ailleurs. Mais devenu président, je n’ai plus voulu mélanger mon argent avec celui du club. Ma doctrine, c’était mettre sur pied une véritable économie. Un club comme une entreprise. En huit ans, je n’ai jamais fini une saison en déficit, comptes contrôlés par la ville de Perpignan. Parfois des joueurs sont venus dans mon bureau avec des propositions venues de Biarritz par exemple. Ils succombaient à l’argent de Serge Kampf. Je leur disais : « Vas-y ! » Ils repartaient mécontents, c’est sûr. Ils auraient voulu rester à Perpignan avec le soleil, la mer, la montagne et les salaires de Paris, Clermont et Biarritz. Mais je ne pouvais les augmenter. Je n’ai jamais démarré une saison avec un budget prévisionnel en déficit.
Cargol66
Passe du temps sur le forum
Que pensez-vous de tous ces présidents fortunés qui sont arrivés en injectant beaucoup d’argent directement dans les clubs ?
Pourquoi pas ? On est dans un système ouvert et capitalistique. Mais je pense qu’il faut mettre des remparts solides en termes de masse salariale, car les clubs moyens ne pourront pas s’aligner sur les surenchères. Il faut bien comprendre que la masse salariale, c’est ce qui pèse le plus sur le budget d’un club. Il faut beaucoup plus de rigueur qu’il n’y en a aujourd’hui. Car je pense qu’on offre actuellement des salaires qui n’ont rien à voir avec l’économie du rugby. Mais à mon époque, ça commençait.
Vous avez des exemples précis ?
Un jour, j’ai reçu un pilier qui était troisième choix à son poste. Le genre de gars qui n’aurait joué qu’en cas d’épidémie. Je lui avais proposé 8 000 euros par mois. Vous savez ce qu’il m’a répondu ? « Tu te fous de ma gueule ? » Cette scène m’a toujours marqué. 8 000 euros, c’était sept fois le Smic et c’était un gars qui écrivait « Papa » avec trois « P » qui me disait ça. Je lui ai dit : « Tu sais ce que ça représente 8 000 euros dans la vraie vie ? » Il faut que les rugbymen se rendent compte de la réalité. Avec onze ans de décalage, je vois ce que sont devenus les joueurs de cette époque, même les internationaux. On ne peut pas dire qu’il y a de très grandes carrières, à part dans les médias.
Suivez-vous toujours le rugby ?
Oui, mais je ne suis jamais retourné à Aimé-Giral. C’est très chaud ici et je laisse ceux qui dirigent le faire tranquillement.
Le président Rivière a-t-il la même vision que la vôtre ?
Non, pas du tout puisqu’il annonce à l’avance qu’il fera des déficits, entre 1 et 2 millions d’euros. Je crois qu’il en a pronostiqué trois pour le prochain exercice. Ce n’est pas ma façon de voir les choses. Lui, c’est un mécène à fonds perdus.
Revenons sur Carter ? Auriez-vous aimé réussir ce recrutement ?
J’en aurais rêvé évidemment. Mais je pense que nous n’en avions pas les moyens. Quand Paul Goze a réussi ce coup, j’ai dit « Chapeau ! » Quatre ans après, on était en Pro D2, avec un gros déficit. Ce gros déficit, c’est Rivière qui en a hérité pendant que Paul Goze partait à la Ligue en milieu de saison. Ça, tout le monde sait le faire.
Ces gens qui vous ont mis dehors, les avez-vous revus pour vous expliquer ?
Non, pourquoi discuter avec des gars qui ne voulaient le pouvoir que pour s’informer sur le recrutement, se tenir au courant des potins et flatter leur ego. Mais ils ne s’intéressaient pas à la gestion du club. Ils ne proposaient rien. Je faisais des réunions auxquelles ils ne venaient pas.
On entend de-ci de-là des supporters regretter votre présidence. Ça doit vous faire plaisir. Ne voulez-vous pas revenir ?
Non, la page est tournée pour moi. Ce n’est plus la même façon de faire. Je ne dis pas que si un jour l’Usap est en grande difficulté, je ne donnerai pas un coup de main mais je me dis que tant qu’il y a un mécène qui donne de l’argent, il faut qu’il reste le plus longtemps possible.
Avez-vous de l’animosité envers François Rivière ?
Pas du tout, on s’appelle, on se voit, nos enfants et petits-enfants sont dans la même école.
Quels sont les gens de cette période que vous avez considéré comme de vrais amis ?
Roland Génis, capitaine de l’équipe de 77, que je considère presque comme un frère. Il y en a d’autres, mais ils se comptent sur les doigts de la main.
Au niveau des joueurs, lesquels vous ont le plus impressionné ?
Il y en a un surtout, le deuxième ligne canadien Mike James que je suis allé chercher à Vancouver. Il nous a montré ce que c’était que le professionnalisme, la préparation physique, la diététique. Il y a eu aussi la cohorte des Argentins, notamment Rimas Alvarez Kairelis, et sa grande éducation. Un grand Monsieur. Les Argentins eux, ils connaissent les valeurs du rugby.
Quid des jeunes formés sur place ?
La formation, c’est l’association qui s’en occupait. Mais on a vu percer les Mas, Guirado, Perez. Bernard Goutta, aussi, était un grand capitaine, même si on m’a souvent opposé à lui. On s’est découvert sur la fin et j’ai vu qu’il avait de vraies valeurs. On n’a pas toujours été d’accord, parce qu’il me la faisait à l’affectif, mais quand il est parti à Colomiers, on s’est téléphoné et il m’a dit : « C’est vrai Marcel, on ne peut pas toujours dire oui. » Il faisait référence à des contrats, parce que finalement tout revient à ça.
Avez-vous des idées qu’on pourrait appliquer au rugby professionnel moderne ?
Je pense à une proposition qu’avait fait René Bouscatel : fermer le championnat de France pendant trois ans, ce serait une façon de faire venir des investisseurs plus sereinement. C’est toujours d’actualité. Ensuite, je trouve que la proposition de Bernard Laporte de faire une Coupe du monde des clubs très intéressante. Car la Coupe d’Europe s’essouffle. Au niveau de Perpignan, je suis admiratif du travail des treizistes et de Bernard Guasch. Je me dis que l’avenir est la mise en commun des moyens des deux rugbys avec des passerelles et des économies d’échelle. Pourquoi pas un centre de formation commun ou ce genre de choses ?
« Je suis admiratif du travail des treizistes et de Bernard Guasch. Je me dis que l’avenir est la mise en commun des moyens des deux rugbys avec des passerelles et des économies d’échelle. Pourquoi pas un centre de formation commun ou ce genre de choses ? »
Pourquoi pas ? On est dans un système ouvert et capitalistique. Mais je pense qu’il faut mettre des remparts solides en termes de masse salariale, car les clubs moyens ne pourront pas s’aligner sur les surenchères. Il faut bien comprendre que la masse salariale, c’est ce qui pèse le plus sur le budget d’un club. Il faut beaucoup plus de rigueur qu’il n’y en a aujourd’hui. Car je pense qu’on offre actuellement des salaires qui n’ont rien à voir avec l’économie du rugby. Mais à mon époque, ça commençait.
Vous avez des exemples précis ?
Un jour, j’ai reçu un pilier qui était troisième choix à son poste. Le genre de gars qui n’aurait joué qu’en cas d’épidémie. Je lui avais proposé 8 000 euros par mois. Vous savez ce qu’il m’a répondu ? « Tu te fous de ma gueule ? » Cette scène m’a toujours marqué. 8 000 euros, c’était sept fois le Smic et c’était un gars qui écrivait « Papa » avec trois « P » qui me disait ça. Je lui ai dit : « Tu sais ce que ça représente 8 000 euros dans la vraie vie ? » Il faut que les rugbymen se rendent compte de la réalité. Avec onze ans de décalage, je vois ce que sont devenus les joueurs de cette époque, même les internationaux. On ne peut pas dire qu’il y a de très grandes carrières, à part dans les médias.
Suivez-vous toujours le rugby ?
Oui, mais je ne suis jamais retourné à Aimé-Giral. C’est très chaud ici et je laisse ceux qui dirigent le faire tranquillement.
Le président Rivière a-t-il la même vision que la vôtre ?
Non, pas du tout puisqu’il annonce à l’avance qu’il fera des déficits, entre 1 et 2 millions d’euros. Je crois qu’il en a pronostiqué trois pour le prochain exercice. Ce n’est pas ma façon de voir les choses. Lui, c’est un mécène à fonds perdus.
Revenons sur Carter ? Auriez-vous aimé réussir ce recrutement ?
J’en aurais rêvé évidemment. Mais je pense que nous n’en avions pas les moyens. Quand Paul Goze a réussi ce coup, j’ai dit « Chapeau ! » Quatre ans après, on était en Pro D2, avec un gros déficit. Ce gros déficit, c’est Rivière qui en a hérité pendant que Paul Goze partait à la Ligue en milieu de saison. Ça, tout le monde sait le faire.
Ces gens qui vous ont mis dehors, les avez-vous revus pour vous expliquer ?
Non, pourquoi discuter avec des gars qui ne voulaient le pouvoir que pour s’informer sur le recrutement, se tenir au courant des potins et flatter leur ego. Mais ils ne s’intéressaient pas à la gestion du club. Ils ne proposaient rien. Je faisais des réunions auxquelles ils ne venaient pas.
On entend de-ci de-là des supporters regretter votre présidence. Ça doit vous faire plaisir. Ne voulez-vous pas revenir ?
Non, la page est tournée pour moi. Ce n’est plus la même façon de faire. Je ne dis pas que si un jour l’Usap est en grande difficulté, je ne donnerai pas un coup de main mais je me dis que tant qu’il y a un mécène qui donne de l’argent, il faut qu’il reste le plus longtemps possible.
Avez-vous de l’animosité envers François Rivière ?
Pas du tout, on s’appelle, on se voit, nos enfants et petits-enfants sont dans la même école.
Quels sont les gens de cette période que vous avez considéré comme de vrais amis ?
Roland Génis, capitaine de l’équipe de 77, que je considère presque comme un frère. Il y en a d’autres, mais ils se comptent sur les doigts de la main.
Au niveau des joueurs, lesquels vous ont le plus impressionné ?
Il y en a un surtout, le deuxième ligne canadien Mike James que je suis allé chercher à Vancouver. Il nous a montré ce que c’était que le professionnalisme, la préparation physique, la diététique. Il y a eu aussi la cohorte des Argentins, notamment Rimas Alvarez Kairelis, et sa grande éducation. Un grand Monsieur. Les Argentins eux, ils connaissent les valeurs du rugby.
Quid des jeunes formés sur place ?
La formation, c’est l’association qui s’en occupait. Mais on a vu percer les Mas, Guirado, Perez. Bernard Goutta, aussi, était un grand capitaine, même si on m’a souvent opposé à lui. On s’est découvert sur la fin et j’ai vu qu’il avait de vraies valeurs. On n’a pas toujours été d’accord, parce qu’il me la faisait à l’affectif, mais quand il est parti à Colomiers, on s’est téléphoné et il m’a dit : « C’est vrai Marcel, on ne peut pas toujours dire oui. » Il faisait référence à des contrats, parce que finalement tout revient à ça.
Avez-vous des idées qu’on pourrait appliquer au rugby professionnel moderne ?
Je pense à une proposition qu’avait fait René Bouscatel : fermer le championnat de France pendant trois ans, ce serait une façon de faire venir des investisseurs plus sereinement. C’est toujours d’actualité. Ensuite, je trouve que la proposition de Bernard Laporte de faire une Coupe du monde des clubs très intéressante. Car la Coupe d’Europe s’essouffle. Au niveau de Perpignan, je suis admiratif du travail des treizistes et de Bernard Guasch. Je me dis que l’avenir est la mise en commun des moyens des deux rugbys avec des passerelles et des économies d’échelle. Pourquoi pas un centre de formation commun ou ce genre de choses ?
« Je suis admiratif du travail des treizistes et de Bernard Guasch. Je me dis que l’avenir est la mise en commun des moyens des deux rugbys avec des passerelles et des économies d’échelle. Pourquoi pas un centre de formation commun ou ce genre de choses ? »
