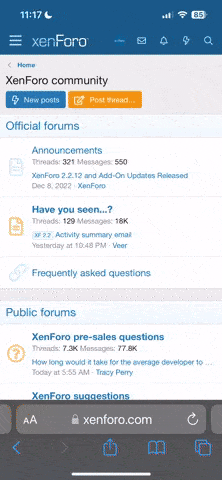Après trois semaines, un premier constat peut être fait. Nous ne sommes ni des chinois, ni des coréens. Nous ne pouvons nous faire au confinement et à l'isolement qu'il implique. Nous tenons trop à notre liberté de mouvement et notre vie sociale. Nous sommes inaptes aux règles tacites et aux gestes barrière, trop indisciplinés. Nous ne pouvons imaginer vivre avec un masque devant le nez, alors même que nous ne nous lavons même pas les mains en sortant des chiottes.
Le problème est que nous avons un rapport à la mort qui n'est pas adapté au reste. Nous voudrions sauver tout le monde. C'est notre plus grande angoisse, ce qui met tout le corps médical à genoux. Nous n'acceptons pas l'idée que des gens puissent mourir d'une épidemie et c'est pourquoi nous nous efforçons d'appliquer des comportements qui sont contre notre nature. Il suffirait d'accepter cette fatalité pour reprendre nos vies normales, en laissant mourir ceux qui sont les plus vulnérables au virus et ne peuvent lutter. Sélection naturelle qui ferait que l'an prochain le nombre de victimes serait bien moindre, jusqu'à ce qu'un nouveau virus fasse son apparition. Déjà cette pandémie a amené nombre de familles, dont la mienne, à accepter de voir partir des proches qui étaient alités depuis des mois dans un état qui ne pouvait qu'empirer, mais que l'on ne pouvait se résoudre à "laisser partir". Avec la nécessité de libérer des lits, la question a été vite réglée. Accepter la mort, et laisser se poursuivre la vie, nous ne sommes pas faits pour ça non plus. C'est ce qui rend l'équation difficile à résoudre.