RCNM-USAP. Avant le derby de dimanche à Narbonne, rencontre avec Benjamin Beaux, disparu des radars du rugby pro depuis un an.
«Mais vous êtes au courant que j’ai arrêté de jouer?» Au bout du fil, Benjamin Beaux s’étonne. Demain, 365 jours se seront écoulés depuis son dernier match professionnel. Une victoire de l’USAP contre Bayonne à Aimé-Giral. Un anonyme 23-10 qui restera comme la dernière apparition du flanker. Il n’avait pas trente ans, il ne s’en doutait peut-être pas encore, mais sa carrière était déjà derrière lui.
«Faut pas chercher d’explications à tout», balancera-t-il dans le courant de l’interview, sur un café à l’angle des halles de Narbonne.
L’histoire est connue. Enfant du RCNM, Benjamin Beaux le quitte pour l’USAP en 2012, sur les conseils de Patrick Arlettaz, alors coach des trois-quarts. Deux saisons minées par les blessures, qui le décideront à quitter prématurément le rugby pro. Jamais les Catalans n’auront vu son vrai visage.
«Perpi ne m’annonce pas qu’ils ne me gardent pas, c’est moi qui bataille pour avoir des infos. Je vais au devant, je vais à la rencontre des dirigeants. Je m’en doutais un peu: j’ai eu beaucoup de blessures, je n’ai pas pu beaucoup jouer. Je m’étais déjà un peu préparé, mais on se raccroche toujours à un petit espoir.»
L’élégance n’a pas seulement disparu des terrains. Comme à Narbonne, il se heurte à la froideur des cols blancs.
«Je ne parle que de ce que j’ai connu. À Narbonne, avec les Australiens, c’était compliqué. À Perpignan, c’était un peu compliqué aussi. Les dirigeants c’était des mecs qui gèrent ça comme une entreprise. Donc avec le bon et le mauvais côté du monde de l’entreprise. Avant, il y avait quand même certaines valeurs. On pouvait prendre des décisions, mais au moins ça se prenait entre quatre yeux et puis ça ne sortait pas de la pièce.»
Les sourires de circonstances recouvrent toujours l’évocation des douleurs passées. Car à Perpignan, Benjamin Beaux a brutalement mélangé plaisir et souffrance.
«Sans faire de généralité, les Catalans sont des personnes sur qui on peut compter. Même dans la concurrence ça reste droit. Il n’y a pas de coup bas. Venir à l’USAP, avec le recul, ce n’est pas une déception du tout. À Narbonne, je faisais ce qu’il fallait, je n’en faisais pas plus. À Perpi, notamment avec Jean-Pierre Perez, j’ai vu quelqu’un qui bossait dur pour être au niveau. J’ai rencontré des gens entiers, sur qui l’on pouvait compter.» Une jouissance de vestiaire qu’il n’aura que trop peu goûtée. Tout l’inverse de l’infirmerie, qu’il squattera abondamment.
«Je me suis fait mal à l’épaule. À partir de là ç’a été catastrophique. J’ai fait cinq ou six rechutes sur cette même épaule. J’ai essayé de faire toujours mieux dans la rééducation. Je faisais des efforts. On se dit “qu’est-ce que je n’ai pas bien fait? Qu’est-ce que je pourrais faire de mieux pour la prochaine fois?” Ça, c’est dur psychologiquement. Quand tu te fais une blessure par malchance, tu ne peux pas faire autrement. Là c’était toujours pareil. À force de me faire des blessures, je pense que je me suis bousillé les épaules.» Rideau, l’acteur regagne les loges. Il ne remontera plus sur scène.
«Je ne voulais pas partir de la région, faire des bornes pour continuer en pro et grappiller quatre ronds, confie cet amoureux de la mer.
J’ai été déçu des deux dernières expériences sur le plan humain. C’est peut-être arrivé plus tôt que prévu, mais maintenant, c’était temps de tourner la page. C’était le bon moment... Enfin, il n’y a pas de bon moment.» Dix ans de cicatrices et de sacrifices ont façonné sa vie. Mais aussi dix ans vécus à haute intensité, le corps saturé de cette singulière adrénaline propre au sport. À l’aube de ses trente ans, Benjamin, l’épaule en vrac, doit trouver un boulot.
«C’est une période de doute. J’ai passé l’été opéré, à pas faire grand-chose. D’habitude, on s’arrête un peu moins d’un mois et on repart tambour battant à faire des intersaisons et courir comme des idiots. Me retrouver à rien faire à la maison, ç’a été un peu compliqué. Quand tu fais rien c’est un cercle vicieux. J’étais nerveux, heureusement qu’il y avait ma femme. Avant, j’étais plus souvent au stade qu’à la maison. La transition elle a été un peu brutale. Je faisais canapé avec les enfants.»
Par nécessité, pour sauvegarder une certaine hygiène mentale, le désormais ex-pro affronte le réel, la normalité d’un monde loin d’un cocon qui s’était mué en toile d’araignée. Ado à la veille du bac, il se torture l’esprit pour décider de son futur.
«Un Noël, ma femme m’a acheté un poste à souder. J’ai commencé à faire des tables, des conneries pour la maison, des bricoles. Je me suis lancé là-dedans. J’ai été pris dans une formation pour apprendre le métier de soudeur. Je travaillais comme ça, quand ça me piquait le dimanche, trois-quatre heures grand max. Là, je me suis retrouvé dans une formation à travailler toute la journée. Tous les apprentis sont dans une période de leur vie où ils sont un peu comme moi, en reconversion ou en transition.» Délicate à gérer, la confrontation tardive avec le monde du travail recèle pourtant des trésors d’humilité. Un grand écart parfois aussi.
«J’apprends sur moi. Ça te permet de relativiser, de voir qu’il y a pire que toi. Il y en a un paquet qui galèrent. Je peux pas me permettre de râler, j’ai gagné de l’argent en jouant au rugby, j’ai quand même derrière le chômage. Il y a des mecs, vraiment, qui sont au RSA et qui peuvent pas se payer un cadenas pour fermer leurs casiers. J’ai pas le droit de me plaindre.» Demain encore, il repartira pour une journée de formation. Et en juillet peut-être, diplôme en poche, Benjamin soudera, soudera, soudera. Pour trente ans encore peut-être. Mais dans un coin de sa tête et de son cœur, les vibrations des rucks, le brou

des tribunes, le cliquetis des crampons sur le carrelage résonneront toujours.
«J’ai l’embarras du choix pour compenser le rugby. Mais rien ne remplace cette émotion. Tu gagnes en groupe, tu es content d’avoir fait le boulot avec tes copains et tu bois une bière après. Ça c’est le sport co. Je sais pas où je vais le retrouver ça. Je suis jeune, j’ai trente ans. Dans ma tête, l’an dernier j’étais en cadet. Ça passe vite quand même...» Dimanche, ce n’est plus le couloir des vestiaires mais les 500 mètres qui séparent son logement du stade de Narbonne qu’il va remonter.
«J’ai du mal à aller dans les stades», lâchera-t-il. Douloureuse conclusion.

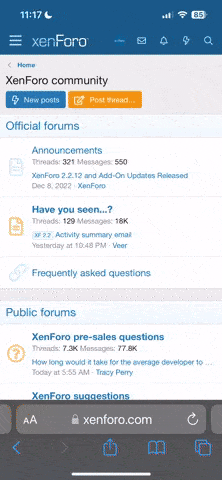
 des tribunes, le cliquetis des crampons sur le carrelage résonneront toujours.
des tribunes, le cliquetis des crampons sur le carrelage résonneront toujours.